Le 71ème Festival de Cannes a connu un début de saison chahuté avec le public iranien "Everybody Knows" du réalisateur iranien Asghar Farhadi et a mis plusieurs jours à servir tout ce qui a fait l'unanimité (vainqueur de la Palme d'Or) Les «Shoplifters» de Hirokazu Kore-eda), mais à la fin, même ceux qui étaient sceptiques semblaient s'être mis d'accord sur le fait que la qualité globale de cette édition américaine, légère et légère, était plus élevée que d'habitude. En revenant sur 12 jours de découverte, voici une douzaine de films qui ont le plus impressionné les principaux critiques de variétés, Owen Gleiberman et Peter Debruge.

BlacKkKlansman
Spike Lee a fait trois films extraordinaires qui lancent des pétards raciaux incendiaires: le classique "Do the Right Thing" (1989), le majestueux "Malcolm X" (1992), et le sauvage (et incroyablement méconnu) Satire au visage noir "Bamboozled" (2000). Ici, pour la première fois depuis, il crée un spectacle zeitgeist brûlant de la bigoterie américaine mise à nu. "BlacKkKlansman", qui se déroule à Colorado Springs au début des années 70, est un thriller secret, à la fois léger, sinistre et profondément drôle. Il incarne John David Washington en tant que Ron Stallworth, un flic recrue aussi furtif que Invisible Man de Ralph Ellison, qui infiltre le chapitre local du Ku Klux Klan en usurpant l'identité d'un raciste blanc au téléphone. Adam Driver, en tant qu'officier, se joint au chapitre en personne et bouscule ces haineux des petites villes, si ouverts sur la laideur de leur paranoïa "Keep America white!" Qu'ils pourraient presque être … les voix de l'alt-right aujourd'hui. L'histoire est ingénieuse mais légèrement fendue, jamais plus que lorsque Stallworth se lie avec David Duke (Topher Grace), le Grand Sorcier du KKK qui met un visage civilisé sur le terrorisme racial. "BlacKkKlansman" est un autre pétard Lee, et quand il sortira cet été, vous feriez mieux de croire qu'il va exploser. -Owen Gleiberman

Climax
Le dernier plongeon de Gaspar Noé dans la zone interdite est un film de choc de la drogue, et pendant 45 minutes c'est fascinant. Nous sommes dans un studio de répétition qui ressemble à un abri anti-bombes, où 20 jeunes danseurs exécutent une performance EDM à double articulation et krump-in-overdrive qui est l'une des séquences de danse les plus étonnantes que vous ayez jamais vues. Noé nous montre ensuite qui sont ces gens – au moins, jusqu'à ce que le LSD dans la sangria à pointes qu'ils boivent entrent en jeu. À ce moment-là, le film devient une descente aux enfers à la fois saisissante et engourdissante; à la fin, moins est devenu plus. Pourtant, comme de mauvais voyages à propos de The Beast Within aller, celui-ci reste une expérience, ce qui explique pourquoi il pourrait avoir été le film le plus buzz à Cannes. -Owen Gleiberman
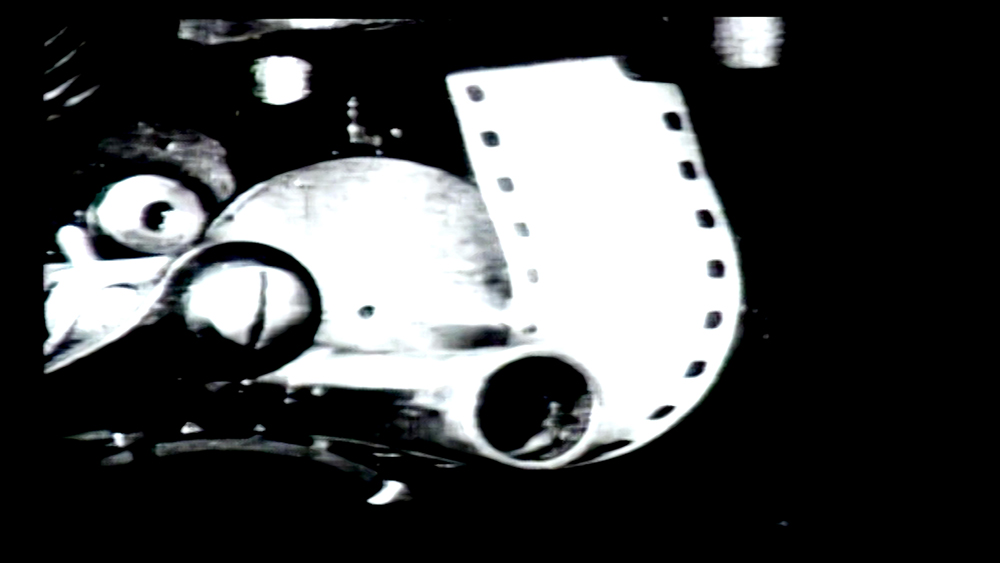
Le Livre d'images
Le nouveau film mémorable de Jean-Luc Godard ressemble à un bulletin. C'est son rare travail qui a l'aura d'un film d'horreur (il est imprégné d'images de violence, de vieux films entrelacés et de nouvelles atrocités), et le monde qu'il regarde à travers son kaléidoscope sémiotique saturé de couleurs est hors de contrôle . Godard, qui est maintenant venu à larguer des acteurs entièrement, travaille dans un mode de collage libre associatif qui suggère MTV rencontre la «Révolution 9» des Beatles. Il arrache les images hors contexte, écraser ensemble des morceaux de musique, de vieux clips et des séquences vidéo de meurtres terroristes pour nous permettre de voir et d'entendre chacun à nouveau. Les assassins politiques semblent mener une version dégradée – ou peut-être accrue – de ce que les films leur ont appris. Sur la bande-son, nous parlant d'une voix si basse, si sonore et si croassante, qu'il a l'air de Charles Aznavour croisé avec Gollum, le Godard de 87 ans dit: «La guerre est là.» Il veut dire que c'est ici, et que ça arrive. -Owen Gleiberman

Bergman – Une année dans une vie
Le portrait de Ingmar Bergman de Jane Magnusson dans l'année charnière de 1957 (bien qu'il couvre toute sa vie et sa carrière) est l'un des portraits les plus honnêtes et débordants d'un artiste de cinéma que vous êtes susceptible de voir. Il décrit Bergman comme le génie de la célébrité tendre et piquant, effusif et démoniaque, tyrannique et à moitié fou qu'il était: un homme tellement absorbé par le travail, et par ses relations obsessionnelles avec les femmes, qu'il semblait mener trois vies. immediatement. C'est en 1957 qu'il a accédé au plateau emblématique de sa puissance créatrice et de sa renommée, et Magnusson montre comment sa charge de travail insatiable consistait à créer une bulle de réalité alternative à l'intérieur: un conte de fées névrosé qui ne devait jamais finir. Ce qui restait à l'abandon étaient ses enfants et ses familles. Sans aucun doute, les films de Bergman étaient sur lui-même (ils se sont révélés être le seul endroit où il pouvait être entièrement sincère), et "A Year in a Life" capture sa faim et son génie, les histoires qu'il devait raconter, et autre chose – un moment au 20ème siècle où un grand nombre de personnes se sont accrochées à des films qui ont transformé les ténèbres de nos cœurs cachés en drames qui vous ont blessé et nettoyé.

Arctic
Un film d'aventure lent et captivant avec Mads Mikkelsen en tant que chercheur-explorateur qui s'est écrasé dans la nature gelée. C'est le premier long métrage réalisé par Joe Penna, le vidéaste brésilien qui a fait sensation sur YouTube, alors on peut s'attendre à ce qu'il soit réalisé avec une touche de flash du 21ème siècle. Au contraire, Penna raconte cette histoire de survie en solo avec une austérité qui donne l'impression, parfois, que vous voyez un remake de «Un homme évadé». Il n'y a pas de raccourcis, pas trop évident seulement … gambits dans les films. Cet homme échoué a peu à compter sur sa volonté, alors nous sentons à chaque pas qu'il peut être nous. Le film est construit autour de la mystique bourrue de Mikkelsen, dont le jeu, comme le cinéma, ne trahit jamais un soupçon de show-biz. Sa taille et sa présence vigoureuse remplissent le cadre, mais son visage regarde vers l'intérieur et vers l'extérieur en même temps; c'est tendu, concentré, ravagé. Le film, dans sa rudesse, traversant la toundra, un pas à la fois, est l'anti – "Cast Away", et c'est ce qui est bien et, enfin, bouger. -Owen Gleiberman

Whitney
Le documentaire de Kevin Macdonald sur la vie et la mort de Whitney Houston est superbement bien fait. Vous ne pouvez pas le regarder sans espérer que d'une façon ou d'une autre, la belle jeune chanteuse ravie que vous voyez trouvera un moyen de vaincre ses démons, qu'ils ne la traîneront pas. La dépendance à la cocaïne, bien sûr, est un monstre insidieux, mais pour voir l'histoire de la vie de Houston est toujours bourdonner d'une seule question: Pourquoi? Pourquoi le chanteur le plus étonnamment doué de sa génération l'obscurité et l'auto-sabotage? La réponse la plus irréfléchie est qu'elle n'aurait jamais dû s'impliquer avec le chien-bête léger B-boy Bobby Brown. Il y a une vérité à cela, mais comme "Whitney" capture c'est une réponse trop facile. Macdonald rend hommage à la béatitude du son de Houston, mais il crée surtout un portrait à multiples facettes de Houston qui nous permet de toucher les forces qui l'entremêlent. Tout est coiffé d'un fusil fumant. : Mary Jones, tante de Whitney et assistante de longue date, affirme qu'il y avait un abuseur sexuel dans sa famille et que Whitney, enfant, était l'une des victimes. Dans un moment chargé, Jones nomme l'agresseur: C'est la chanteuse Dee Dee Warwick (décédée en 2008). C'est la pièce manquante dans une vision potentiellement plausible de comment, et pourquoi, Whitney Houston ne pouvait pas accepter qui elle était. En tant que chanteuse, elle a été honorée avec un cadeau qui pourrait guérir le monde. Mais elle manquait du plus grand amour de tous. -Owen Gleiberman

Oiseaux de passage
Après avoir conduit le public dans des recoins rares de la jungle amazonienne avec "L'Étreinte du Serpent", le réalisateur Ciro Guerra et Cristina Gallego ( ici présenté comme co-directeur) nous montre un côté de l'histoire colombienne qui n'a jamais atteint le monde extérieur, révélant comment les peuples indigènes Wayuu ont été attirés dans les débuts du problème de la drogue du pays – une période connue sous le nom de "la Bonanza Marimbera". "Lorsque des indigènes appauvris, tentés par une chance de richesse illicite, se sont retrouvés pris dans le commerce de la marijuana, qui à son tour a déclenché des explosions de violence qui ont dévasté la communauté. Si cela ressemble à la configuration d'une épopée stéréotypée de trafic de drogue, détrompez-vous. Mélangeant des acteurs établis avec des nonprofessionnels merveilleusement authentiques, Guerra et Gallego se démènent pour documenter les traditions Wayuu, donnant à l'histoire entière une qualité visuellement renversante et hyper surréaliste qui renforce comment une telle activité criminelle menaçait directement un mode de vie presque mystique . – Peter Debruge

Burning
De la même manière que l'hyperphagie a ruiné l'expérience télévisuelle, les festivals de cinéma bouleversent la façon dont les films doivent être vus en obligeant le public à entasser plusieurs projections le même jour. leurs dents dans la prochaine déclaration artistique ambitieuse avant de digérer le dernier. Considérez ceci comme une explication partielle du fait que je ne reçois pas immédiatement le "Burning" du maître sud-coréen Lee Chang-dong, même si aucun film ne m'a encore plus marqué à Cannes – en partie parce qu'il est aux prises avec le désir d'un pauvre personnage un monde injuste et souvent insensé, taquinant méticuleusement certaines possibilités tout en niant des explications faciles à chaque tournant. Ce qui commence comme une romance légère construit inexorablement quelque chose de beaucoup plus complexe – un thriller existentiel, en quelque sorte – comme un écrivain insécurisé s'imagine le protagoniste dans un mystère de son propre imaginaire, qui n'existe peut-être pas, et dont l'ambiguïté irréconciliable hante encore moi une douzaine de projections plus tard. – Peter Debruge

Guerre froide
Après avoir lutté dans l'obscurité pour la première partie de sa carrière, le réalisateur Pawel Pawlikowski a surpris tout le monde en réalisant un film d'art en noir et blanc intitulé Ida, qui lui a valu Oscar en langue étrangère pour le pari. Maintenant, après avoir découvert une approche qui lui a valu le respect dont il avait envie, il faut beaucoup moins de courage pour faire un second film dans le même format, et pourtant, "Cold War" est plus accompli et satisfaisant à bien des égards, relâchant l'austérité bressonienne quelque peu pour livrer un film noir élégant sur l'impossible relation entre un musicien polonais (Tomasz Kot) et la belle jeune chanteuse (Joanna Kulig) qu'il recrute avec la claire intention de séduire. Le film a été non seulement mis en scène, mais aussi écrit dans un état d'esprit pré-# MeToo, et pourtant, comme dans "Ida", Pawlikowski a non seulement créé un rôle féminin formidable, mais a découvert une étoile dans le processus. – Peter Debruge

Fille
Ce fut une bonne année pour le cinéma LGBT à Cannes, avec deux films gay en compétition ("Sorry Angel" de Christophe Honoré et "Knife + Heart" de Yann Gonzalez) les offres de la boîte ont saupoudré tout au long de la gamme. Le Queer Palm et la Caméra d'Or (récompensant le meilleur premier long métrage) ont mérité les débuts sensuels du réalisateur belge Lukas Dhont: un regard intime, infiniment racontable, sur la bataille acharnée d'une jeune fille de 15 ans pour devenir une ballerine compliquée par le fait que l'aspirant danseur en question est né dans le corps d'un garçon. Les cinéastes ont lancé un casting ouvert pour trouver leur acteur, Victor Polster, qui jongle avec les nombreuses demandes du film, tout en incarnant littéralement le conflit du film – qui n'est ni des parents conservateurs ni des intimidateurs homophobes. interne, où la transformation du jeune personnage ne se passe pas aussi vite qu'elle le voudrait. – Peter Debruge

Heureux comme Lazzaro
Aussi divers que les 21 films de la compétition officielle cannoise cette année, aucun ne semblait plus surprenant que le troisième long métrage d'Alice Rohrwacher, qui débute comme une fable moderne et se termine une critique déchirante de ceux qui ont été négligés et exploités par le capitalisme contemporain. Adoptant un style qui rappelle le cinéaste et poète italien Pier Paolo Pasolini, le réalisateur mélange le réalisme robuste avec une touche surnaturelle, en présentant un jeune métayer très acharné nommé Lazzaro qui, dans sa naïveté aux grands yeux, pourrait être le Chauncey Gardiner d'un tabac en déclin – un peu mou dans la tête, mais doté d'une sorte de magie. Bien que vous ne sachiez jamais où ce film se dirige, quelque chose de particulièrement inattendu se produit à mi-chemin qui place le conte déjà unique sur un parcours tout à fait nouveau. Certains spectateurs regardent quand l'histoire change, bien que ce soit là que, comme des voix relativement nouvelles, Rohrwacher prouve qu'elle a quelque chose de nouveau à dire. – Peter Debruge

Voleurs à l'étalage
Contrairement à une grande partie du monde occidental, le vol est si rare au Japon que les gens laissent souvent leurs bicyclettes stationnées déchaînées. Du point de vue culturel, cela suggère à quel point la honte doit être profonde pour un clan de petits délinquants qui comptent sur le vol à l'étalage pour survivre dans le drame familial profondément humaniste de Hirokazu Koreeda. «Tout ce qui se trouve dans un magasin n'appartient à personne», explique l'ersatz de la figure paternelle du gang, et d'une manière étrange, cette logique s'étend à la petite fille abandonnée qu'il trouve affamée et frissonnante en rentrant chez elle un soir. Parce que ses parents ne veulent manifestement pas de l'enfant, l'homme l'adopte essentiellement (d'autres pourraient dire «kidnapper»), mettant en place le regard le plus sensible du réalisateur sur le sens de la famille. Comme le personnage de Sakura Andô demande désespérément vers la fin, «Est-ce que l'accouchement est suffisant pour faire de vous une mère?» Il s'avère que la réponse n'est pas aussi simple que nous le pensions. – Peter Debruge
VIDÉO ASSOCIÉE:










